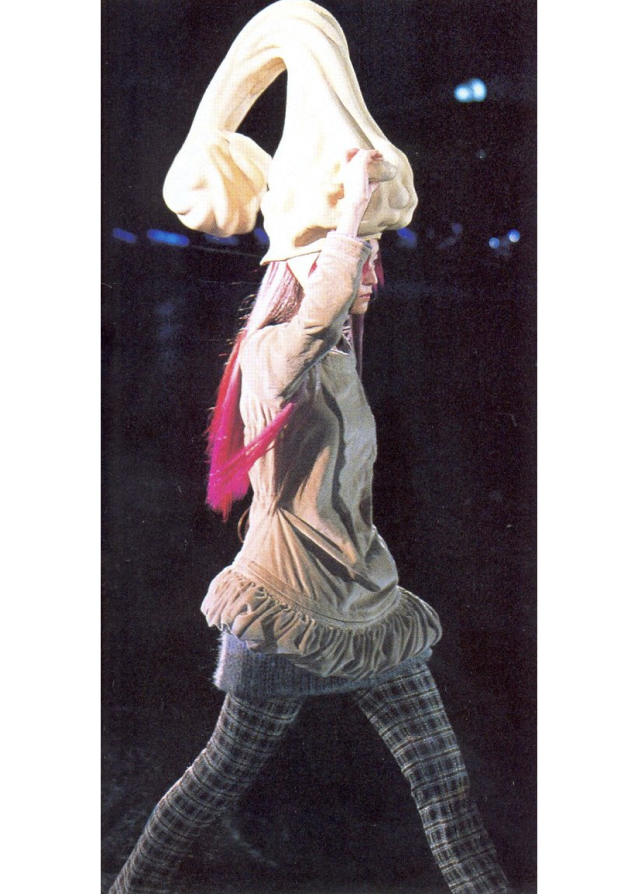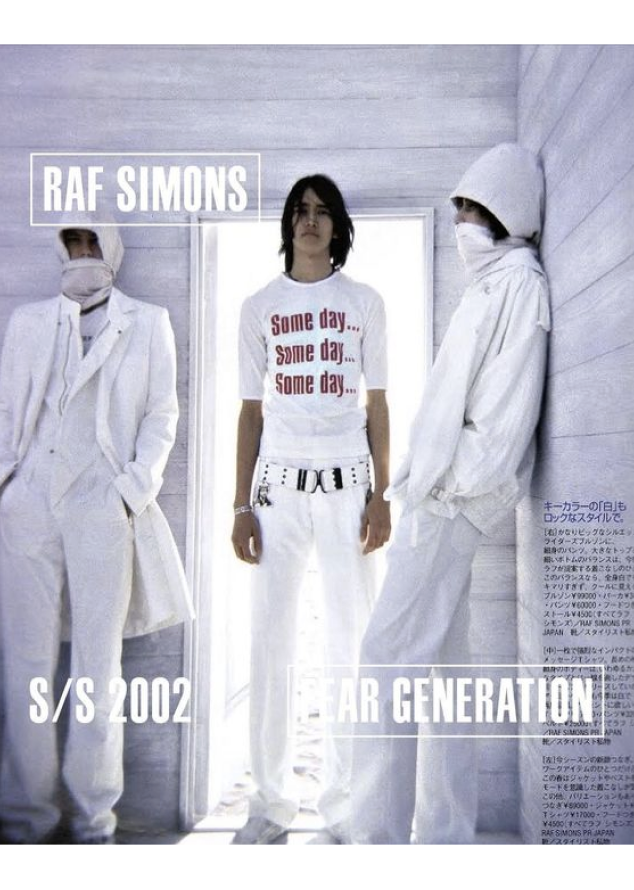Sur les Héros de SF Post-Apocalyptique
- November 2023
★~(◡﹏◕✿) TO READ WITH
« Globalement, dans les deux œuvres à l’étude, les personnages sont nés dans des univers et environnements déjà constitués, sans souvenir du passé, de la rupture ou de l’effondrement »
Le 28 octobre 2021, à l’occasion de l’événement Connect, Mark Zuckerberg introduit Meta Platforms, soit la fin de Facebook Inc. Le conglomérat d’applications et d’entreprises, qui se compose de Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Oculus, n’opère plus sous le nom de « Facebook ». Il devient la traduction et la tentative de concrétisation d’un projet plus « grand », d’une vision de l’avenir propre et chère à Zuckerberg : celle du métavers. L’avènement de Meta Platforms opère une transformation radicale au sein du groupe, mais aussi pour les utilisateurs et leur attitude vis-à-vis du conglomérat d’entreprises. La multiplicité, la singularité et la particularité de chaque application, en même temps qu’elle donne l’illusion du choix individuel et volontaire de l’exposition de soi, permet de disperser le principe de concentration des données utilisateurs en un seul et même pôle, à savoir Facebook Inc. soit Facebook. Du fait de sa réputation sulfureuse et de la multiplication des scandales, dont celui de Cambridge Analytica révélé en 2018 par un ancien salarié de la firme de consulting, Christopher Wylie, le rebranding de Facebook Inc. en Meta Platforms réinstaure une forme d’indéfinition bénéfique au groupe. Au-delà des stratégies marketing mises en place pour apaiser la méfiance des utilisateurs, le choix de la terminologie adoptée par Zuckerberg et son équipe redéfinit nos émotions vis-à-vis du groupe et semble porter en elle la promesse d’une ère nouvelle. Meta nous dévoile ses ambitions programmatiques et les trajectoires de développement et d’innovation numériques et virtuelles du groupe sous la forme d’une utopie technologique aux accents proprement dystopiques.Meta apparaît comme une cellule familiale auto-suffisante, concentrant les applications et réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde – en témoigne la récente création de Thread, concurrent direct de Twitter. Elle sous-entend une évolution du groupe au-delà des frontières qu’il avait créées, érigées et définies ; elle serait la promesse du déploiement et de la continuation de l’existence humaine dans un espace de réalité virtuelle : le Metavers. Le Metavers, tel qu’il nous est proposé par Zuckerberg, a ceci de spécifique qu’il concentre un réseau d’activités quotidiennes dans le virtuel. Il sera donc possible de rejoindre amis et familles au sein d’Horizon Home, de réaliser toute forme de communication en réalité virtuelle, jouer à des jeux-vidéo, regarder des films, pratiquer du sport, travailler. Meta se propose donc de déplacer les structures de notre vie quotidienne dans un espace de réalité augmentée au moyen d’un casque Oculus, de même qu’Apple nous aura proposé de prolonger notre expérience à travers Apple Pro Vision (Keynote, Juin 2023, WWDC 2023). Ces réseaux d’innovations pensés comme des systèmes de facilitation de la vie des usagers et utilisateurs se donnent comme des « révolutions » techniques. Cependant, il sera intéressant de remarquer que nous peinons progressivement à y donner notre assentiment. Les critiques « à chaud » qui en sont faites sur d’autres plateformes de réseaux sociaux dont Tik Tok auront le plus souvent tendance à reprendre les terminologies propres au registre du dystopique. Précisément car, le principe imaginaire de légitimation qui soutient ces innovations est celui d’une utopie technologique qui permettrait d’alléger et d’apaiser la réalité et l’ordre des choses du monde contemporain. Bercé par l’utopie de la décentralisation, de la fin de la régulation étatique et de la création d’un nouvel individu libéré des vices du monde réel et maître de ses échanges sur la Blockchain et dans le Metavers, l’individu Web 3 est en réalité maintenu dans l’illusion de la transparence formelle du réseau. L’argumentaire se poursuit également dans l’utopie de la non-distinction et de la création d’un système alternatif de normes et de valeurs toujours plus inclusif. Celui-ci viendrait contrebalancer les défaillances systémiques contemporaines et héritées au moyen de cryptomonnaies, d’avatars, de Web 3 Fashion, et de parcelles de land que l’on pourrait acheter et développer au sein d’une map au développement infini. S’il faut noter que le Metavers et ses ambitions salvatrices nous sont donnés dans une forme et pratique discursive qui n’est autre que celle du marketing, la notion instaure une rupture plus que manifeste dans les ambitions technologiques de la Silicon Valley. Cependant, elle est aussi et surtout signifiante en cela qu’elle témoigne de l’actualisation des imaginaires génériques de la science-fiction dans le réel. Elle rend visible une forme de coïncidence entre les fictions narratives et cinématographiques génériques de la science-fiction et la réalité/actualité. Comme si le futur avait déjà été écrit, le geste effectué par Mark Zuckerberg dans son choix terminologique n’est pas anodin. Théorisé une première fois en 1964 par Philip K. Dick dans son ouvrage Simulacres, le terme est connoté par Neil Stephenson en 1992 dans Le Samouraï Virtuel où le Metavers est présenté comme une préfiguration du Web sous la forme d’un univers virtuel similaire à celui du jeu Second Life. Le Metavers n’est plus question de fiction narrative. De fait, il existerait une double coïncidence au sein de l’ouvrage postcyberpunk de Stephenson et la vision de Zuckerberg : une similarité accrue entre le contexte socio-politique qui soutient la narration et le contexte états-unien contemporain – comme si Meta avait pris pour seuil de référence le contexte fictif pour exister. Mais on relève également une forme de coïncidence entre la finalité du récit de Stephenson et le discours de légitimation de Meta, dont les ambitions ne seraient autres que celles d’un projet de communauté autonome et décentralisée. Le déplacement des activités humaines dans le virtuel permettrait en apparence une réduction de notre impact anthropique et donc environnemental. Comme principe même de la prolongation de l’existence humaine dans le virtuel, les gas fee seraient une des clés de la redevance de l’humanité à l’environnement. Meta et ses dérivés sous-entendent plutôt des questions de définition et de cadres d’effectuation des représentations et imaginaires dystopiques dans le réel. Quelles limites techniques, technologiques, mais aussi esthétiques nous permettent de décider du caractère utopique ou dystopique d’un phénomène ou d’une innovation ? Les quelques années d’existence de la Blockchain, des plateformes metaverselles et des NFT semblent plutôt constituer un résumé succinct et efficace de l’histoire du capitalisme, de la rémanence des idéaux méritocratiques et American Dream-like. Justement, on pourrait les penser dans une forme de tension dialectique dont la résolution ne se trouve ni dans le cyberespace ni dans les formes de discursivités qui lui sont attribuées, mais plutôt dans une forme d’attention au monde et à l’état actuel des choses qu’elles semblent éviter. Elles mettent en lumière une première forme de tension esthétique, représentationnelle mais aussi politique telle qu’elle est manifestée dans le premier chapitre de l’opuscule Dystopia: A Natural History, intitulé « Rethinking the Political Dystopia » : « Utopia’s peace and plenitude now seem to rest upon war, empire, and the ruthless suppression of others, or in other words, their dystopia. Then there is the virtuous society of Utopia itself. Here we discover that suppressing vice requires extraordinary regulation and surveillance. »1 Les utopies numériques, d’apparence non violente, reposent pourtant sur la « suppression » du soi dans une surexposition individuelle choisie et volontaire. Cette rupture fondamentale du rapport à soi est manifeste d’une première rupture ou fracture de la modernité qui est à penser en contexte anthropocénique. La rupture instaurée par cette nouvelle ère géologique mais aussi humaine2 nous offre un contexte théorique adéquat pour penser cette coïncidence entre fiction et réalité. Mais elle nous permet également de poser la question des limites, des limites de notre représentation, de notre agentivité et de nos imaginaires. La pertinence de la science-fiction comme outil méthodologique pour penser l’anthropocène réside dans la production de fictions narratives ayant pensé les conséquences et l’impact anthropique de l’humanité en général, mais aussi d’un certain groupe d’individus concentrant l’autorité et les pouvoirs. En cela, lorsque nous soutenons que Meta prend sans doute pour seuil référentiel celui du Samouraï Virtuel, c’est car ce seuil référentiel préfigurait lui-même les ruptures de l’Anthropocène. Ces ruptures sont à la fois esthétiques, politiques, sociales, économiques, environnementales, etc. Selon nous, au-delà de la proximité situationnelle qui émane des récits de science-fiction et l’anthropocène, c’est aussi car les narrations des genres que sont le cyberpunk, postcyberpunk et biopunk posent la question des limites, de la rupture que la science-fiction illustre des formes de pratiques esthétiques de l’anthropocène. Le genre narratif s’est donc hissé, un peu malgré lui, au rang de schème imaginaire et visuel référentiel dans le contexte anthropocénique. L’attention spécifique portée à la dystopie, sans nécessairement la reléguer au rang de l’imaginaire, de l’inconcevable ou de l’inactuel, nous permet de proposer une analyse de la résurgence du dystopique et de la coïncidence entre fiction et réalité en tant qu’une pratique esthétique de l’anthropocène autonome et méthodologiquement éclairante dans nos constructions éthiques. Ce serait donc que l’anthropocène et ses résonances avec la science-fiction nous permettrait de reposer des questions clés : celle du statut et de la pertinence de la promesse dans le contexte actuel, celles des espaces et conditions d’effectuation de la promesse d’avenir dans un monde et espace de plus en plus hostile à l’humanité en général, celles de notre rapport à la négativité et à l’histoire, etc. Ces questionnements font de Nietzsche un auteur plus que mobilisé dans les réflexions théoriques sur l’anthropocène et l’urgence climatique. On en entendra un premier écho dans La Généalogie de la Morale, lorsqu’il expose que « le véritable travail de l’homme sur lui-même pendant la plus longue période de l’espèce humaine, tout son travail préhistorique, prend ici sa signification et reçoit sa grande justification, quel que soit d’ailleurs le degré de cruauté, de tyrannie, de stupidité et d’idiotie qui lui est propre : ce n’est que par la moralité des mœurs et la camisole de force sociale que l’homme est devenu réellement appréciable. ». Le problème de l’anthropocène est bien celui de la rupture et de l’arrachement de l’humanité de son caractère « appréciable ». Cette inappréciabilité de l’humain à l’environnement et à son espace d’existence fait alors problème au sens où elle nécessite de penser et des formes d’acception et de métabolisation de la situation et l’implémentation de systèmes de résolutions viables et efficaces. Nous pensons que la science-fiction et les personnages qu’elle met en situation, arrachés à la « moralité des mœurs et à la camisole de force sociale », nous permettent de penser un « après ». Elle nous permet de théoriser, d’anticiper et de modéliser cette fin subie du « travail de l’homme » puisqu’il est devenu, à un moment charnière de son existence (individuelle et collective), profondément inappréciable. Nietzsche intervient non seulement comme un penseur de la rupture pour les penseurs en écologie, mais aussi comme une ressource pour repenser l’éthique4, l’oubli et les trajectoires de l’humanité dans un avenir sans l’impossible retour à l’ère prémoderne. Ainsi, dans notre étude, nous tâcherons d’interroger la science-fiction non seulement comme schème visuel et imaginaire référentiel, mais comme outil méthodologique clé pour penser une « éthique du futur », pour reprendre l’expression de Jonas. Nous interrogerons les « héros » de science-fiction des sous-genres cyberpunk, postcyberpunk et biopunk comme des êtres en situation et principe de modélisation et représentation anticipées du réel à venir. Selon nous, nous résonnons avec ces personnages car ils existent fictivement dans des environnements similaires aux nôtres. Leurs destins, leurs trajectoires existentielles se voient le plus souvent remis en cause par le système qui les a engendrés. Dès lors, dans des moments de tensions climatiques, ils mettent en place une forme d’heuristique de la déviance et sont ceux qui peuvent promettre, ceux que nous souhaiterions pouvoir être. Nous étudierons en particulier deux héros qui évoluent dans un contexte similaire : Akane Tsunemori, jeune inspectrice à la Sécurité Publique dans l’anime à succès Psycho-Pass (2012) écrite par Gen Urobuchi, et l’officier K, blade runner au LAPD dans Blade Runner 2049 (2017) réalisé par Denis Villeneuve, les deux travaillant pour les systèmes de sécurité de leurs États dans des sociétés ultra-panoptiques. Dans un premier temps de notre analyse, nous nous concentrerons sur la et les coïncidences entre fictions narratives génériques et réalité, ce qui nous mènera à nous poser la question des structures et processus de comparaisons qui nous animent et participent de la relégation imaginaire des éléments dystopiques qui conjuguent le réel ainsi à l’aune des pratiques esthétiques de l’anthropocène. Cette première analyse nous permettra d’interroger la science- fiction et ses héros comme des outils méthodologiques pertinents pour construire une éthique du futur en ce sens qu’ils nous permettent de penser la ruine, la force motrice et active de l’oubli et une heuristique de la déviance. La mobilisation des récits de science-fiction comme outils référentiels dans le discours n’est pas nouvelle. La science-fiction, à différents moments de l’histoire contemporaine, sert d’outil de comparaison et d'étalon de mesure pour évaluer la teneur « dystopique » du réel. Cependant, on observe que cet usage référentiel procède le plus souvent à une relégation imaginaire des phénomènes, permettant alors de minimiser leur impact et leur réalité.
On pourrait aisément postuler une forme de contamination des imaginaires et narrations de science-fiction dans le réel. Des renvois et retours multiples à 1984 de Georges Orwell à l’aspect visionnaire de Contagion (2011) réalisé par Peter Soderbergh durant la pandémie de COVID-19, jusqu’à la prédictibilité du réel proposée par la série Black Mirror créée par Charlie Brooker, etc. La science- fiction s’est insérée dans nos pratiques discursives et esthétiques de l’anthropocène. Cependant, nous pensons que les structures de comparaisons et d’assimilation qui soutiennent le discours participent d’une relégation de la réalité/actualité des problèmes dans l’imaginaire. Elles fonctionnent non pas comme une dialectique de « l’identité et de la différence », comme dynamique fondamentale des utopies politiques6, et donc bénéfique, mais comme une dialectique de la « mêmeté et de la différence ». Ainsi, lorsque nous mentionnons le caractère « dystopique » d’une situation ou d'un événement, nous n’établirions qu’un constat purement discursif et discriminant. Le qualificatif et la notion même de « dystopie » sont par-là évidés de leur sens, de leur portée symbolique et ultimement de leur capacité transformationnelle. On observe une tendance accrue à ce type de comparaison à l’avènement de cataclysmes et catastrophes climatiques dans des zones de peuplement humain notamment (urbains et ruraux). On pourra y attribuer deux attitudes non concurrentes. La première consistant en la qualification et la description purement discursive de l’événement et de ses effets dans le registre du dystopique. Elle fait le constat et tente de susciter une réaction par l’émotionnel et les réseaux d’images et de symboles évoqués par les termes utilisés. La seconde, reprenant la première, la subvertirait subtilement en affirmant une forme de fatum de la situation. Elle maintient l’attentisme voire permet de cultiver une posture nihiliste. Si la première tire la sonnette d’alarme et enjoint - dans une moindre mesure - à l’action, elle participe de la relégation imaginaire et symbolique de l’urgence climatique à un réseau d’images et de mythologies de la « nature » culturellement situées. La seconde pose à la fois la question de nos modes de conscientisation de l’urgence climatique, par exemple, mais aussi la question de nos pratiques et usages du monde. Elle pose la question de notre capacité à agir en situation dans un contexte d’effondrement progressif des structures de la morale et des systèmes de valeurs, des écosystèmes et des possibles humains sur terre. Dresser le constat de la coïncidence entre les narrations de science-fiction et la réalité, de même que mobiliser les imaginaires dystopiques et apocalyptiques doit selon nous dépasser le stade de la discursivité pure. On relèvera une pluralité d’attitudes vis-à-vis de l’urgence climatique, de la crise environnementale et de l’apparente restructuration du réel en « dystopie mondaine ». On pourra y associer un panel significatif d’éco-émotions8. Cependant, il est nécessaire d’entendre à travers ces deux attitudes et tendances discursives qu’elles sont symptomatiques d’un refus d’intégration de la réalité et de l'actualité de la situation vécue collectivement par l’ensemble de la biosphère. Elles reposent le plus souvent sur des schémas de pensées bipartisans empêchant, une fois de plus, de redéfinir et de clarifier le discours. Elles seront donc à penser à l’aune d’une matrice de valeurs bien spécifique, le plus souvent socialement et politiquement située. Afin d’entendre cette première impasse de la relégation imaginaire de la dystopie, on se référera à Georges Marshall lorsqu’il analyse les attitudes qui empêchent une reconnaissance de l’urgence et de son actualité, ainsi que la mise en place et l’implémentation de systèmes de résolutions qui impliquent une transformation des pratiques du « monde » :
« ... attitudes toward climate change fit into a larger matrix of values, politics, and lifestyles. Thus, as Kahan, Leiserowitz, and others at Yale argue, there are identifiable “interpretive communities”: people who believe or disbelieve in climate change—and one can predict with some accuracy who they are, how they live, who they trust, and where they receive their information. Over the past ten years, detailed profiles have emerged. »
D’où la nécessité de prêter attention aux pratiques esthétiques de l’anthropocène afin d’entendre les impasses du discours dans la mise en pratique de systèmes de résolution. Les considérations imaginaires et symboliques, le codage culturel de l’anthropocène et les modes de représentations de la « crise climatique » sont, selon nous, des éléments clés. Si les différentes communautés interprétatives répondent majoritairement aux schémas politiques des modes de gouvernance occidentales et aux divisions partisanes, elles se saisissent des éléments culturels qui peuplent les schèmes imaginaires et visuels référentiels de la science-fiction. Nos questions sont alors les suivantes : la permanence d’un climat dystopique à l’ère contemporaine, en contexte anthropocénique, empêche-t-elle la mise en place de systèmes de résolution effectifs ? Utilise-t-on le qualificatif « dystopique » afin de moraliser l’urgence sans agir directement sur les mœurs ? Y a-t-il des modalités alternatives pour penser la dystopie afin de pouvoir l’utiliser comme un référentiel actif ? Peut-on mobiliser la dystopie et sous quelles formes pour penser le futur et construire ce que Jonas appelle une « éthique du futur » ?
Nous souhaiterons alors établir une différence entre les modalités d’effectuation narratives et esthétiques de la dystopie dans la fiction et les éléments principe d’identification de la dystopie. Si l’un est de récit et de narration, l’autre est d’assimilation et de comparaison. Le premier défini et encadre l’action, le second isole et particularise. Nous ne penserons donc pas la dystopie comme antonymique à l’utopie, mais plutôt comme un système de représentation, d’encadrement de l’action et mode de qualification du réel autonome. Si l’on se donne pour tâche de dresser une typologie des formes de coïncidence entre représentation dystopique, fictions narratives et réalité, cette distinction est donc à mobiliser. Le terme « dystopie » évoque un panel d’images plurielles qui elles-mêmes renvoient à la multiplicité des imaginaires ou situations dystopiques que l’on peut recenser. La dystopie n’exclut pas de nouvelles formes et de nouvelles images encore jamais pensées, conceptualisées ou rencontrées dans le réel. En introduction de son ouvrage Dystopia: A Natural History, Gregory Claeys, dans un moment où il invite à repenser la dystopie, dresse une brève typologie des représentations associées au terme. Globalement, le terme évoque tant des représentations visuelles, imaginaires et fictives que des situations et phénomènes climatiques, politiques ou encore socio-économiques :
“We see landscapes defined by ruin, death, destruction. We see swollen corpses, derelict buildings, submerged monuments, decaying cities, wastelands, the rubble of collapsed civilizations. We see cataclysm, war, lawlessness, disorder, pain, and suffering. Mountains of uncollected rubbish tower over abandoned cars. Flies buzz over animal carcasses. Useless banknotes flutter in the wind. Our symbols of species power stand starkly useless: decay is universal.”
Claeys détaille plus amplement les différents types d’images que l’on prête à la dystopie. Cependant, on observe que la majorité des éléments listés font référence à des situations réelles, observables : contexte de guerre, récession économique, catastrophe nucléaire ou climatique, etc. Et si ces images se sont progressivement banalisées dans la période de l’après-guerre, elles portent encore en elles des échos apocalyptiques faisant du réel un espace d’existence non désirable pour certains et un espace de transformation et d’effectuation de soi pour d’autres. Claeys poursuit alors en mentionnant que "Most of what we associate with ‘dystopia’ is thus a modern phenomenon, wedded to secular pessimism." Dans un premier temps, il nous faudra rappeler la teneur non-eschatologique des dystopies littéraires et cinématographiques à l’étude. D’autre part, il nous faut insister sur le fait que la coïncidence entre fiction et réalité, pensée dans les cadres de la science-fiction, vient du fait que le réel est matériau d’inspiration des fictions de la fin du monde. La coïncidence n’est donc pas d’ordre prédicatrice ou messianique, mais plutôt d’anticipation et d’extrapolation de l’existant. On entendra dès lors la problématique des relégations à l’imaginaire et à la fiction de la dystopie en ce sens qu’il y a, comme l’explicite Claeys, des usages empiriques du terme12. Dès lors, il nous est possible d’approcher les narrations de science-fiction non pas seulement d’un point de vue esthétique, mais plutôt formel et d’entendre les structures de modélisation du réel qui y prévalent, les modes de déploiement de la narration et l’analyse de l’existant qui y est effectuée. La diffusion des récits de science-fiction dans l’imaginaire collectif, sa constitution en schème imaginaire référentiel doit donc être approchée dans une perspective formelle et non purement discursive. Auquel cas, elle est reprise esthétiquement par une multiplicité d’acteurs qui capitaliseront sur ses imaginaires et réseaux symboliques afin de donner l’illusion de la différence et de la transformation. L’industrie du textile et de la mode capitalisera sur l’avènement de micro-trend comme l’Avant-Apocalypse ou encore le Wasteland Punk dont les fondements anti-adultes permettent à l’individu de se percevoir comme un héros de SF, de se sentir comme en train de se préparer à un hypothétique effondrement. L’univers de la Tech capitalisera sur des utopies de la résolution de la crise par la technique en passant du Metavers et des cryptomonnaies aux investissements en R&D visant à créer des abeilles artificielles afin de polliniser les plantes en cas d’apocalypse biologique13. L’industrie agro-alimentaire présentera les OGM comme principe de résolution de la crise alimentaire à venir, etc. Les imaginaires dystopiques, postapocalyptiques, effondristes ou encore néo-utopistes proposés par certains genres de la science-fiction reposent en partie sur une analyse de l’existant. Or, il nous semblera de prime importance d’analyser les relations représentationnelles établies entre ces schèmes imaginaires référentiels et l’existant (social, politique, économique, historique, etc.). On prendra donc pour référence les narrations de la fin des temps, les dispositifs narratifs utilisés et les différentes formes de narration du réel, encore les systèmes d’inclusion et d’inversion tels qu’ils sont évoqués par Frederic Jameson dans Archeologies of the Future.
Ces relations représentationnelles s’illustrent dans des pratiques esthétiques de l’anthropocène, une culture visuelle de l’anthropocène qu’il conviendra d’interroger. Il s’agit donc d’une culture visuelle des limites, symboliques des fractures et ruptures imposées par cette nouvelle ère au sens où Tommaso Guariento entend l’anthropocène comme une pensée des « limites de l’expansion de notre espèce, limites que l’on a commencé à dépasser au début de la modernité »14. Guariento, lorsqu’il entend analyser les pratiques esthétiques de l’anthropocène, établit quatre « fractures de la modernité » auxquelles il associe « trois esthétiques mises en place par les œuvres narratives et cinématographiques, liées à l’anthropocène ». Il liera la quatrième fracture, la « fracture transcendantale », pensée sous l’égide de « Kant et Nietzsche », comme « l’impossibilité de penser en dehors de la corrélation entre pensée et être », soit « l’impossibilité de penser le « Grand Dehors », le réel qui s’étend en dehors de notre cognition, se manifeste dans l’état de désorientation qui effraye l’homme moderne après l’avènement de la mort de Dieu ». En somme, la fracture transcendantale se manifeste dans l’impossible retour du mythe et de la religion, l’impossibilité de penser toute forme d’eschatologie. Mais cette fracture témoigne également d’un arrachement de l’homme à son rapport aux mythes et au religieux. S’il nous est impossible de réduire la culture visuelle de l’anthropocène aux imaginaires postapocalyptiques, les imaginaires de fin du monde et de la ruine sont des référents visuels signifiants. On précisera, dans la lignée de Tommaso Guariento, entendre par esthétique « un mode de perception, sorte de schéma iconique et narratif qui constitue le cadre des représentations du futur ». Ce qui nous semble pertinent dans l’analyse de Guariento, c’est que l’esthétique apocalyptique et les « apocalypses modernes sont « sans salvation » tant au niveau psychologique qu’au niveau narratif. (...) l’esthétique apocalyptique (est) comme une structure visuelle et narrative qui représente une catastrophe sans rédemption ni jugement final entre les bons et les méchants ». En somme, dans l’esthétique apocalyptique se niche la dissolution des structures de la morale, elle présuppose un sujet dont la procession dans le réel ne peut se rapporter à « la moralité des mœurs et la camisole de force sociale » qui rendent l’individu « appréciable »15. S’il prend pour référence de cette esthétique Le Cheval de Turin de Bela Tarr (2011), dont Nietzsche est un des protagonistes clés, nous souhaiterons analyser la teneur de cette esthétique dans son espace d’effectuation le plus fréquent : celui de la science- fiction. Le héros, personnage principal des œuvres de science-fiction cyberpunk, postcyberpunk ou encore biopunk, s’incarne dans la rupture, la scission. Il retrouve, par-là, une certaine forme d’autonomie.
Le personnage de Max, incarné par Matt Damon dans Elysium (2013) réalisé par Neill Blomkamp, évolue dans un Los Angeles postapocalyptique, transformé en favela en 2154. La Terre, foncièrement hostile à l’homme, est plongée dans un climat d'ultra-violence, de catastrophes climatiques et de surpopulation. Max rêve de se rendre sur la station orbitale Elysium, où des cabines médicales appelées "medbox" permettent la régénération cellulaire. Pour y parvenir, il devient malgré lui un héros en aidant Spider à pirater les données bancaires d'un riche élyséen. Malgré lui, car irradié lors d’un accident de travail au sein d’une usine de construction de droïdes nommée Armadyne, c'est en échange d’un accès à une medbox que Max accepte cette « mission ». Il est motivé par sa propre survie plutôt que par une moralité altruiste. Si l'on peut postuler qu’une forme d’instinct primaire motive l'action de Max, il faudrait plutôt se référer à ses choix comme non guidés par la morale, pour-soi. Ainsi, il conviendra d’étudier les structures d’effectuation de l’action des héros de science-fiction postapocalyptique et la façon dont ils répondent au principe nietzschéen de la « volonté propre, indépendante et persistante », celle de « l’homme qui peut promettre », telle qu’elle est évoquée dans la seconde dissertation de La Généalogie de la Morale. La contamination de la science-fiction dans l’imaginaire collectif et sa constitution en schème imaginaire et visuel référentiel ne consiste pas dans la défaite de l’humanité. Selon nous, la science- fiction en tant que genre littéraire et cinématographique, mais aussi et surtout comme exercice de pensée, est un outil méthodologique pertinent. Elle nous permet de penser l’anthropocène, mais aussi et surtout d’apprendre à habiter l’anthropocène par l’imaginaire. Du fait de sa variété générique et thématique, le genre permet de modéliser une multiplicité de situations et d’enjeux du monde humain et non-humain. Prenant l’existant pour principe, les récits de science-fiction ne sont pas acosmiques et portent en eux des considérations environnementales. Qu’il en aille du déploiement de la fiction dans des univers hypermodernes et ultra urbanisés ou dans des espaces en ruine, dans des espaces terraformés, elle nous dit toujours quelque chose de la situation climatique de ces espaces. « Avec ses récits qui sont autant d’expériences de pensée, la science-fiction peut fournir un support utile pour élargir ou compléter des réflexions déjà plus ou moins engagées, voire pour en amorcer de nouvelles. Quels gains la science-fiction pourrait-elle apporter à ce que Hans Jonas avait appelé une « éthique du futur » ? Autrement dit, (...) « non pas en l’éthique qui prévaudra dans un avenir indéterminé mais bien toute éthique qui érige en impératif absolu la préservation d’un futur habitable par l’humanité », voilà la question introduite par Yannick Rumpala lorsqu’il considère « Les Ressources de la science-fiction pour habiter l’Anthropocène et construire une éthique du futur ». La science-fiction nous permet d’analyser, formellement, les problèmes de concordance temporelle entre les évolutions techniques et l’éthique ainsi que la modification des structures d’effectuation de l’action humaine. Ainsi, en construisant des fictions narratives dans un horizon prospectif et spéculatif toujours-déjà impliqué dans des considérations environnementales, la science-fiction est un outil méthodologique pertinent. On entendra alors la science-fiction à la fois comme « un mode de représentation, mais elle peut aussi être prise comme un « mode de problématisation », au sens de Michel Foucault lorsqu’il vise « la manière dont les choses font problème » », nous dit Yannick Rumpala. Les êtres de science-fiction, même si produits de l’imagination, sont « en situation », pensés dans une « forme culturelle historiquement située » qui nous donne à voir les possibles de l’existence humaine en prolongeant les structures du système actuel. Il est donc aisé de croire en une forme de capacité suprahumaine et prédicatrice des auteurs et réalisateurs de science-fiction si l’on tombe dans l’écueil de la relégation imaginaire des coïncidences entre fictions et réalité. Même si la science-fiction est un genre qui peine à acquérir ses « lettres de noblesse », elle maintient son lecteur dans une forme d’illusion de vérité comme « croyance à une improvisation, à une apparition éclair tenant du miracle », une « science de l’art (devant) contredire cette illusion » comme le souhaitait Nietzsche. Consisterait donc en une analyse méthodologique, formelle et représentationnelle de la science-fiction. Justement, si nous donnons plus globalement notre assentiment à la science-fiction, ce n’est pas car elle prédit, mais plutôt car elle est fruit d’une intelligence combinatoire qui permet ce prolongement de l’existence humaine « en donnant des représentations de leurs possibles répercussions sur les existences ». Elle nous révèle ce que nous pouvons être, de manière individuelle et collective, dans des contextes d’habiter qui n’ont rien de souhaitable. On remarquera alors des formes de coïncidences entre réel et fiction proprement appréciables et globalement saluées. Notre adhésion progressive aux narrations de science-fiction et la popularité du genre se traduit concrètement dans l’adhésion progressive des individus aux personnalités telles qu’Edward Snowden ou encore Julian Assange. Elles se traduisent dans le réconfort éprouvé à l’annonce du départ de Dr. Hinton de chez Google après avoir prévenu des « dangers de l’Intelligence Artificielle ». Des figures et modèles d’action individuelle située et autonome que l’on peut rapprocher de celles des héros de science-fiction, dont l’agent K dans Blade Runner 2049 ou Akane Tsunemori dans Psycho-Pass.Ni l’agent K ni Akane Tsunemori ne sont ce que l’on pourrait appeler des lanceurs d’alerte comme Snowden ou Assange. Ils performent plutôt des formes de déviances au sein même du système avant d’en être ostracisés d’une manière ou d’une autre. Mais la proximité qui se tisse entre ces figures fictives et réelles réside dans le sentiment d’humanité qu’elles nous offrent et dans la capacité de faire advenir la rupture dans l’ordre des choses. Leur existence s’apparente à une tentative d’accès inconsciente à l’« individu souverain, l’individu qui n’est semblable qu’à lui-même, l’individu affranchi de la moralité des mœurs, l’individu autonome et supramoral (car « autonome » et « moral » s’excluent), bref l’homme à la volonté propre, indépendante et persistante, l’homme qui peut promettre, — celui qui possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu’il a enfin atteint par-là, de ce qui s’est incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance, enfin le sentiment d’être arrivé à la perfection de l’homme »19. Ou simplement, ils incarnent, dans la rupture, un moment de « la volonté propre ». Dans le cadre de la science-fiction, il nous est plus aisé de penser les étapes d’affranchissement de l’individu et de l’avènement de la volonté propre dans une forme de totalité narrative. Les héros de science-fiction consistent en une ouverture vers le possible de la déviance, la mise en place de stratégies à la fois de survie et de subversion des structures de coercition et de surveillance. Mais ce qui, selon moi, permet l’action autonome et la déviance des héros de science- fiction, c’est leur contexte d’existence. Globalement, dans les deux œuvres à l'étude, les personnages sont nés dans des univers et environnements déjà constitués, sans souvenir du passé, de la rupture ou de l’effondrement. Akane Tsunemori existe fictivement en 2112 au Japon, où le système informatique Sybil a réalisé le « monde parfait », capable d'analyser et de quantifier la santé mentale et morale des citoyens au moyen d’un Psycho-Pass, en enfermant les criminels potentiels et en exterminant les criminels. Si Blade Runner nous semble moins éloigné temporellement, l'an 2049 répond aux visions que s’en faisait Philip K. Dick en 1962 dans Les Androïdes Rêvent-ils de moutons électriques ? C’est dans la ruine d’un ordre ancien, mais post-moderne, qui ne nécessite pas nécessairement d’apocalypse, que ces visions dystopiques du futur illustrent l’impossibilité de « faire mémoire »20. Nous dirons que la ruine possibilise à la fois l’oubli et l’impossibilité de faire mémoire chez les héros de science-fiction, alors même qu’ils existent dans des sociétés de l’archivage et de l’anticipation des comportements individuels. D’où la forte impression sur le lecteur que ces héros maîtrisent leur destin d’une manière novatrice, alors qu’ils travaillent pour les institutions qui instaurent et maintiennent cet ordre. Les dilemmes éthiques auxquels ces deux personnages sont en butte se soldent par de nombreuses étapes de désobéissance et donc d’actions guidées par la seule force de leur volonté individuelle. C’est par-là qu'ils regagnent un contrôle réel sur leur destin. La dissolution des injonctions morales et de leur registre d’effectuation (social, émotionnel, sensoriel, physiologique, etc.) est l'un des topos clés des fictions postapocalyptiques. Les personnages, en ce qu’ils font face aux incohérences et défaillances systémiques, doivent alors se réapproprier leur existence et décider par et pour eux-mêmes. Il leur est le plus souvent impossible de faire la mémoire des injonctions morales et des normes en vigueur comme nous le faisons, de leurs évolutions, d’en établir une réelle généalogie. Dès lors, s’ils oublient et mobilisent l’oubli comme une force active, c’est car ils n’ont pas d’étalons de mesures, de principes de comparaison historique leur permettant de mobiliser l’histoire ou la mémoire comme argument tangible et de faire valoir leur discours. Dans "Blade Runner 2049", les réplicants, humanoïdes et esclaves modernes, n’ont pas la capacité de mémoire. La mémoire des réplicants est synthétique, elle leur est implantée, leurs existences sont conditionnées par de faux souvenirs. L’agent K revivra et continuera à faire sa vie avec sa compagne holographique Joi par le biais de ces faux souvenirs, de même que Joi n’existe que comme un prolongement de ses états d’esprit. La tension climactique est à son apogée dans le film lorsque K est en proie à une réminiscence au contact d’un objet en bois - vestige de l’ancien monde. Il doit se souvenir, mais se pose également la question de la véracité de ce proto-souvenir. Il se rend donc chez le Dr. Ana Stelline, une éditrice de rêve qui confirme la réalité du souvenir de K. Il s’agit alors pour K de suspendre son adhésion à des souvenirs implantés pour chercher une forme de vérité du souvenir et donc un principe de réalité. Dès lors, K devient un « homme libre, le détenteur d’une vaste et indomptable volonté, trouve dans cette possession son étalon de valeur : en se basant sur lui-même pour juger les autres, il vénère ou méprise ; et de même qu’il honore fatalement ceux qui lui ressemblent, les forts sur qui on peut compter (ceux qui peuvent promettre) ». Symboliquement, ce passage à un nouvel état de l’âme et à une procession constante vers « l’humain » est rendu manifeste par le départ de K d’un Los Angeles ultra-moderne et d’une nature dévastée par des dérèglements climatiques et systémiques d’origine anthropique, à sa procession dans le désert et dans les ruines. K trouvera dans la ruine, puis dans les bas-fonds de Los Angeles, soit dans des espaces reclus et invisibles, invisibilisés, son étalon de valeur et sa capacité à promettre comme les membres de la résistance réplicante ayant retrouvé une maîtrise sur eux-mêmes et leur destin à la naissance de l’enfant réplicant car alors peut-être « plus humains que les humains » (Mariette). Akane Tsunemori retrouvera sa capacité à promettre et agira dans les cadres de sa volonté propre alors même qu’elle est détenue par le système Sybil pour trahison. Il n’est pas question pour K ou encore Akane Tsunemori de vivre ces moments de réorientations existentielles comme principes de distinction radicale de l’humanité ou « des autres ». Bien au contraire, ils nous présentent « à chaque fois des manières de ressentir un rapport de l’humanité au monde, dont on peut profiter autrement que comme un matériau inerte à analyser dans ses aspects principalement formels ». Ils ne rejettent ni négativité, ni adversité, ni ne nous permettent de présumer de résolution narrative sous la forme d’un happy ending. Bien au contraire, ils s’illustrent comme référents au sens où ils rendent compte, formellement, du processus organique, biologique et circonstanciel de la vie humaine. En mettant en scène des héros emprunt à des dilemmes moraux au sein de sociétés néo- utopiques et profondément dystopiques, la science-fiction nous permet d’éprouver des situations à venir. Elle nous permet de comprendre en quoi « la moralité des mœurs et la camisole de la force sociale » reposent sur une véridicité discursive et conceptuelle plutôt que praticable. Une fois modalisées et extrapolées, celles-ci nous permettent de mettre en lumière des « individus » certes fictifs, mais en situation dont le principe d’existence n’est pas la correspondance de leurs actions aux systèmes normatifs et coercitifs, mais plutôt ce que la déviance leur permet d’accomplir et l’accomplissement personnel et collectif qu’ils trouveront en elle. L’attention spécifique portée à la dystopie, sans nécessairement la reléguer au rang de l’imaginaire, de l’inconcevable ou de l’inactuel, nous permet de proposer une analyse de la résurgence du dystopique et de la coïncidence entre fiction et réalité en tant qu’une pratique esthétique de l’anthropocène autonome et méthodologiquement éclairante dans nos constructions éthiques. TRAVAUX CITÉS : Claeys, Gregory. (2016). Dystopia: A Natural History, "Rethinking the Political Dystopia". Oxford Academic, p.6. Nietzsche, Friedrich. (1900). La Généalogie de la morale. Traduit par Henri Albert. Mercure de France [Troisième édition]. Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche, vol. 11, p. 85-160. Guattari, Felix. (1989). Les Trois Ecologies. Morton, Timothy. (2013). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, "A Quake In Being". University of Minnesota Press. Albrecht, Glenn. (2005). Solastalgia: A new concept in human health and identity. Philosophy Activism Nature, 3(41), 41-55. Marshall, George. (2014). Don't Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Bloomsbury Publishing. Chapter 5. https://www .theguardian.com/environment/2018/oct/09/robotic-bees-could-pollinate-plants- in-case-of-insect-apocalypse T. Guariento. (2018). Chapitre 11. Voir le refuge. Culture visuelle de l’Anthropocène entre catastrophe et construction des niches. Dans Rémi Beau (éd.), Penser l’Anthropocène. Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », p.173-197. Y. Rumpala. (2018). Chapitre 10. Sur les ressources de la science-fiction pour apprendre à habiter l’Anthropocène et construire une éthique du futur. Dans Rémi Beau (éd.), Penser l’Anthropocène. Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », p. 157-172.